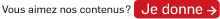Comment se fait-il que des banques comme Citigroup, Merrill Lynch et UBS, pourtant dotées de sommités, se soient à ce point fourvoyées avec les crédits hypothécaires à risque ? La haute direction, toute-puissante, y est pour quelque chose. Démonstration.
Auteurs : Paul Strebel et Hongze Lu BUSINESS STRATEGY REVIEW
En un clin d’œil, les grandes banques du monde entier se sont mises à perdre des dizaines de milliards de dollars, et ce, en raison d’investissements désastreux. C’était en 2008. Le monde entier découvrait l’ampleur des crédits hypothécaires à risque aux États-Unis, les fameux subprimes. Un nombre considérable d’Américains étaient subitement incapables de respecter le paiement de leurs dettes hypothécaires, si bien que les institutions financières se retrouvaient face à un énorme déséquilibre entre leur actif et leur passif. Pour s’en sortir, certaines ont eu besoin de l’aide financière du gouvernement (et l’ont parfois obtenue), tandis que d’autres ont carrément disparu, à l’image de Lehman Brothers, dont la création remontait à 1850.
Comment cela a-t-il pu se produire, alors qu’il existe des modèles mathématiques sophistiqués conçus précisément pour éviter de telles catastrophes ? C’est que ces modèles peuvent mener à des erreurs si on ne les adapte pas constamment, à la conjoncture par exemple. Ainsi, la Suisse UBS a longtemps eu la réputation d’être l’une des banques les mieux administrées du monde : sa gestion des risques, parmi les plus prudentes, s’appuyait sur les plus récentes techniques de modélisation, en théorie les plus à même de limiter les risques associés aux placements financiers, et le tout était supervisé par le siège social, à Zurich.###
Mais, et c’était là l’ennui, les recommandations émises par ces modèles mathématiques reposaient sur de froids calculs, et non sur le bon sens. Du coup, les modèles étant basés sur des données issues d’agences d’évaluation de crédit mises sur pied durant la période du boom des prix de l’immobilier, entre 2000 et 2005, les évaluations n’ont pas tenu compte de l’évolution du profil des personnes contractant une hypothèque immobilière, en particulier du fait qu’elles étaient de moins en moins fiables sur le plan financier.
Les données intégrées aux modèles mathématiques indiquaient, par exemple, que les obligations notées AAA ne perdraient jamais plus de 2 % de leur valeur et que, par conséquent, les titres garantis par des créances (TGC ou, en anglais, CDO, c’est-à-dire collateralized debt obligations) et notés AAA pouvaient être convertis en valeurs non risquées grâce à l’achat d’une protection contre une perte de 2 % de leur valeur. L’investissement dans des TGC ainsi « assurés » étant considéré comme sans risque, aucun frein particulier n’a alors été prévu dans le processus de gestion des risques.
Le fonds de couverture interne d’UBS, Dillon Read Capital Management, a été le premier à faire ce genre de placements, et durant les 18 premiers mois, les profits réalisés ont été considérables. Pour tirer parti de la tendance, les courtiers d’UBS se sont mis à faire la même chose pour la banque elle-même, puis le service de la trésorerie, qui place les surplus liquides de la banque en investissements liquides sûrs, a emboîté le pas.
Résultat : chacun étant persuadé de la quasi-infaillibilité des modèles mathématiques, personne ou presque n’a remis en question le procédé qui permettait d’engranger des profits spectaculaires, et ce, même si le simple bon sens aurait permis de déclencher l’alarme, avec des interrogations aussi simples que « Comment se fait-il que des placements soi-disant sûrs rapportent toujours plus que des placements sûrs ? »
Dans les notes qui accompagnent le rapport intérimaire d’UBS sur sa « défaillance », soumis à la Commission fédérale des banques de Suisse, l’ex-PDG Marcel Rohner affirme que l’institution financière, en se fiant trop à son processus de gestion des risques, n’avait pu avoir accès au portrait d’ensemble de la situation. « Personne, écrit-il, ne s’est plus posé de questions élémentaires. La plupart de nos responsables, pleins de bonnes intentions, étudiaient les transactions pour éviter les risques, raffinaient les modèles et faisaient des analyses. Le problème, ce n’est pas qu’ils ne voyaient pas la complexité du processus, mais plutôt l’inverse : il était devenu impossible d’avoir un point de vue critique, de poser des questions appropriées, souvent simples, pendant qu’il en était encore temps. »
Un manque criant d’expertise
Poser des questions directes et pointues quand il y a une possible exposition à des risques majeurs est la responsabilité de la haute direction et du conseil d’administration de toute entreprise. Mais pour y parvenir, il importe que les membres du conseil aient une connaissance suffisante du domaine financier, de même que le pouvoir d’interroger la haute direction sur les risques majeurs encourus par l’entreprise. De fait, comment imaginer que les membres d’un conseil d’administration, même extrêmement compétents dans leur domaine respectif, s’inquiètent des risques que représentent des TGC notés AAA s’ils n’ont aucune expertise du secteur financier ? Et comment s’attendre à ce que ces administrateurs puissent, par exemple, porter un jugement éclairé sur les risques associés à des placements dans un portefeuille de fonds — en anglais, CDO-squared — comportant des obligations multisectorielles adossées à différentes formes de créances ?
Nous avons mené une étude, portant sur une trentaine des plus grandes banques du monde, qui montre une étroite corrélation entre les résultats enregistrés durant la crise financière et le niveau d’expertise en finance des membres du conseil d’administration. Les banques ont été réparties en deux groupes : d’un côté, celles qui ont essuyé le moins de pertes (en moyenne, 13,6 milliards de dollars américains au début de 2009) ; de l’autre, celles qui ont connu un véritable revers lié aux subprimes (en moyenne, 27,9 milliards de dollars américains). Les profils professionnels des membres du conseil d’administration de chaque banque ont été scrutés à la loupe, histoire d’évaluer leurs connaissances dans les domaines bancaire et financier. On a ainsi établi l’expertise des administrateurs et octroyé une note en pourcentage à chaque institution ; le tout a mené à la création d’un palmarès dans lequel Goldman Sachs figure en tête (avec 60 %) et Citigroup en dernier (7,7 %). La moyenne de la note obtenue est de 28 % pour le groupe des banques les moins frappées par la crise, et de 15 % pour celui des banques les plus touchées, parmi lesquelles figurent également Merrill Lynch et UBS.
Chez Citigroup, Charles Prince, président du conseil d’administration et directeur général, n’avait aucune expérience dans les domaines financier et bancaire. Il avait été nommé PDG en 2003 après une série de scandales qui avaient éclaboussé la banque. En tant qu’avocat, il semblait alors la personne la mieux désignée pour régler les problèmes judiciaires associés aux investissements dans Enron, WorldCom, Global Crossing et Parmalat, ainsi que pour s’occuper des accusations de vente illégale de titres en Europe et d’opérations frauduleuses au Japon. Comme il avait été recruté pour mener à bien un assainissement sur le plan juridique, la banque avait même précisé qu’il ne s’occuperait pas de « microgestion ». Les investisseurs avaient réagi avec scepticisme, et le titre de Citigroup avait chuté de 2,6 % le jour même de cette nomination. Dans les années qui ont suivi, et jusqu’en 2008, Citigroup est devenu le plus grand détenteur de TGC liés à des subprimes; le 9 février 2009, les dépréciations et les pertes sur crédits hypothécaires à risque avaient atteint 85,4 milliards de dollars américains, plaçant la banque en tête du groupe des grands perdants.
Les périls de la toute-puissance
Si l’on souhaite que des évaluations sensées des risques soient prises en compte, il est essentiel que la haute direction de l’entreprise — même dotée d’un conseil d’administration réunissant des membres experts en finance — fasse preuve d’ouverture face aux signaux d’alarme qui peuvent émaner des employés de première ligne.
Or, il est difficile d’envisager une telle éventualité lorsqu’un président du conseil et directeur général possède les pleins pouvoirs. Durant la période critique allant du milieu de 2005 au milieu de 2007, au cours de laquelle les banques se sont ruées vers les subprimes, Citigroup, comme on l’a vu, avait à sa tête un président du conseil et directeur général dépourvu de connaissances particulières en finance; chez Merrill Lynch, le président du conseil et directeur général était tout-puissant; et chez UBS, le président exécutif contrôlait tout. Ces dirigeants ont tristement imprimé leur marque sur les banques qu’ils dirigeaient.
Le cas de Merrill Lynch
C’est chez General Motors que Stanley O’Neal a occupé son premier emploi; le constructeur automobile lui a d’ailleurs accordé une bourse pour suivre un MBA à Harvard. En 1986, il s’est joint à Merrill Lynch, où il a gravi les échelons jusqu’au sommet. En 2000, il a été nommé à la tête de la division du courtage, où il a sabré 20 000 postes et fermé 266 bureaux dans le monde, en vue de réduire les coûts de la banque à la suite de la crise déclenchée par les attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center. C’est en partie grâce à ce geste qu’il a été promu au poste de PDG en 2002.
Reconnu pour son style de gestion despotique, le nouveau PDG a alors poussé la banque à prendre de plus en plus de risques dans ses placements et à miser tout particulièrement sur le nouveau secteur des TGC. « M. O’Neal harcelait constamment les cadres supérieurs en leur demandant pourquoi, par exemple, les profits augmentaient plus rapidement chez Goldman Sachs. “À un moment donné, tout le monde souhaitait être absent la journée où Goldman Sachs publiait ses chiffres”, selon les dires d’un ex-cadre supérieur de Merrill Lynch », a écrit le Wall Street Journal.
S’opposer à Stanley O’Neal était risqué. « Ou bien on faisait ce qu’il demandait, ou bien on était congédié », affirme un employé de Merrill Lynch. De fait, le service des titres à revenu fixe était reconnu pour son taux élevé de roulement du personnel.
Stanley O’Neal exigeant des profits rapides, Merrill Lynch est devenue dépendante des bénéfices issus de produits à haut risque. Ainsi, la banque a acquis en 2006 l’initiateur de subprimes, First Franklin, pour 1,3 milliard de dollars américains. L’année suivante, le PDG a délégué la responsabilité de la gestion des risques à Ahmass L. Fakahany, qui avait pourtant peu d’expérience en négociation d’instruments financiers. Les bénéfices sur les investissements à taux fixe ont grimpé de façon spectaculaire, en même temps que les risques. Le problème, c’est que le synchronisme était mauvais : le marché des subprimes et les opérations sur les TGC se sont rapidement taris en 2007. Quand le marché des TGC les mieux notés s’est lui-même épuisé, à la fin de 2007, les membres du conseil de Merrill Lynch ont pris conscience des énormes dépréciations enregistrées par la banque et ils ont licencié Stanley O’Neal. En février 2009, Merrill Lynch a enregistré la seconde réduction de valeur en importance de toutes les banques, à hauteur de 56 milliards de dollars américains.
Le cas d’UBS
Marcel Ospel a été embauché au service de la planification de la Société de banque suisse (SBC) en 1977. Quand il a quitté ce poste pour se joindre à Merrill Lynch, son supérieur à la SBC notait cette évaluation dans son dossier : « Une personne compétente, qui s’évertue à prouver sa valeur; façon de penser plutôt conservatrice ; quelqu’un de très ambitieux, qui pourrait faire des erreurs à cause de cela. A donc besoin de beaucoup de supervision. » Après trois années chez Merrill Lynch, Marcel Ospel est retourné à la SBC, où il a gravi quelques échelons jusqu’à la fusion UBC/SBC, dont il est devenu le chef de la direction. Ses traits de personnalité sont alors apparus au grand jour : son appétit insatiable pour la croissance l’a poussé à prendre des risques.
De 2005 à 2007, les bénéfices d’UBS ont crû de 21%, pour atteindre 2,4 milliards de dollars américains. Mais la chute a été plus forte encore : en février 2009, UBS a enregistré la troisième réduction de valeur en importance de toutes les banques (48,6 milliards de dollars américains).
Chez UBS, le bureau du président était le centre du pouvoir et dominait à la fois le conseil d’administration et l’équipe de direction ; Marcel Ospel contrôlait donc tout. Il recrutait de préférence des cadres jeunes et peu connus, qu’il remplaçait d’ailleurs tous les quatre ou cinq ans. Comme, en plus, les membres du conseil avaient peu d’expérience des marchés financiers, personne ne remettait sa toute-puissance en question. C’est en 2006 qu’il a tenu une conférence téléphonique — aujourd’hui devenue célèbre — avec les plus hauts dirigeants des bureaux étrangers de la banque. Le message était clair : viser la croissance à tout prix pour vaincre la concurrence. Après les résultats lamentables de 2008, Marcel Ospel a dû prendre sa retraite.
La vertu de la rotation
Notre étude indique que les présidents de conseil et directeurs généraux qui volent de succès en succès et qui occupent leur poste pendant plusieurs années deviennent de plus en plus sûrs d’eux-mêmes et finissent par jouir d’un pouvoir quasi total. Leur ambition tend alors à devenir démesurée, sans compter leur croyance à l’effet qu’on leur doit la réussite de l’entreprise. En revanche, les présidents de conseil et directeurs généraux nouvellement nommés sont plus enclins à poser des questions pertinentes et sont plus sensibles à l’exposition au risque; en général, ils n’osent pas se fier exclusivement à leur propre jugement.
De fait, les banques ayant subi les pertes les plus importantes avaient des structures de direction où prévalait la permanence: les membres du conseil et les PDG avaient été en poste en moyenne pendant quatre ans et demi avant 2007. Quant aux autres, il y avait eu en moyenne un changement de président du conseil ou de PDG au cours des deux années et demie précédant l’année 2007.
La rotation à la tête d’une entreprise est par conséquent d’une importance cruciale pour la bonne santé de celle-ci. Les changements aux postes de direction permettent aux cadres de faire leur apprentissage et d’acquérir de l’expérience tout en évitant qu’une seule personne domine la culture d’entreprise. C’est aussi une façon de développer un bassin de candidats aux postes les plus élevés et d’installer une saine compétition interne. Dans le secteur bancaire, il arrive trop souvent que le conseil d’administration laisse le président du conseil et directeur général omnipotent se débarrasser facilement de ses successeurs potentiels et d’autres possibles leaders. En effet, quand il n’y a aucun candidat à l’interne pour lui succéder, le PDG sait que le conseil peut beaucoup plus difficilement lui montrer la porte.
Autre observation : les banques ayant subi les plus fortes pertes donnaient à leurs meilleurs courtiers un véritable statut de star, ce qui permettait à ces derniers d’avoir plus de pouvoir que les contrôleurs ; de leur côté, les banques ayant enregistré des pertes plus faibles réussissaient mieux à modérer les prises de risque de leurs courtiers vedettes. Les banques ayant obtenu de meilleurs résultats avaient souvent une politique claire de rotation des cadres afin que ceux-ci travaillent à la fois en première ligne et au contrôle ; ces banques faisaient en sorte que les avantages pécuniaires liés aux deux types de postes soient comparables.
Sur ce plan, Goldman Sachs est un bel exemple de réussite. Quand le magazine Risk a nommé cette banque Gestionnaire de risques de l’année, en janvier 2008, il a cité en modèle le parcours de Robert Berry, chef de la modélisation mathématique du service de gestion des risques. Robert Berry a en effet d’abord été courtier au secteur des titres à revenu fixe, puis a travaillé pendant trois années dans la salle des marchés de l’entreprise, où il a raffiné les modèles de dérivés de taux, avant d’arriver à la gestion de risques et au contrôle. Grâce à cette politique de rotation, les cadres supérieurs de Goldman Sachs développent de solides compétences en gestion de risques.
Sous étroite surveillance
Puisque la récente récession mondiale provoquée par la crise financière a poussé nombre de présidents de conseil et directeurs généraux et de membres de conseils d’administration de banques vers la sortie, de nouvelles personnes leur ont succédé. Elles sont ainsi confrontées à une question brûlante : pour perdurer, comment devraient-elles gérer les risques ?
Comme nous l’avons vu, les systèmes et les modélisations de gestion de risques, si perfectionnés soient-ils, ne sont pas suffisants pour garantir de bons résultats. Une des leçons que l’on peut tirer de la dernière crise est qu’au niveau des conseils d’administration — tout particulièrement dans un domaine aussi complexe que les banques —, l’expertise financière est plus importante que la diversité des compétences. (Même si les membres d’un conseil sont des sommités dans leur domaine, s’ils n’ont pas assez de connaissances financières, ils sont incapables de poser les questions appropriées en matière d’évaluation des risques.)
L’important est de bien surveiller les actions du PDG, et cette responsabilité incombe au conseil d’administration ou à l’administrateur principal. Plus un PDG récolte de succès et gagne en assurance, plus la supervision doit être étroite. Toutefois, si le président du conseil ou l’administrateur principal acquiert lui-même trop de pouvoir, il peut entrer en conflit avec le PDG ou avec d’autres membres du conseil. Ainsi, pour éviter qu’un PDG ou un administrateur principal ne devienne omnipotent, il est essentiel que tous les membres du conseil jouent activement leur rôle et tirent la sonnette d’alarme chaque fois qu’ils le jugent nécessaire.
Paul Strebel est professeur à la Sandoz Family Foundation et il dirige le programme High Performance Boards à l’IMD (International Institute for Management Development), à Lausanne, en Suisse.
Hongze Lu est chercheur à l’IMD.